La névrose appliquée aux projets : Comprendre pour mieux agir en MOA
Découvrez comment la compréhension des résistances au changement peut transformer/optimiser la gestion de vos projets.
Philippe Viraye
1/2/20255 min read
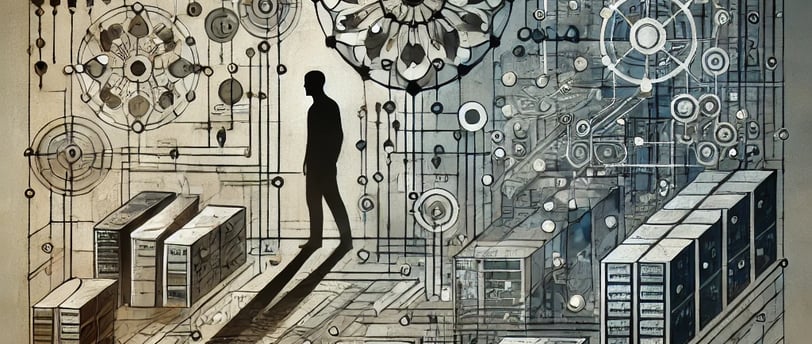
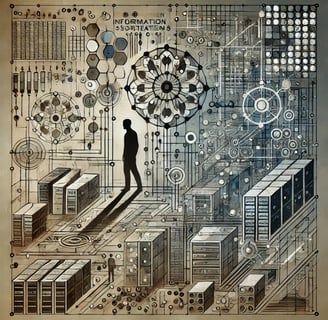
INTRODUCTION : L’humain au cœur des transformations technologiques
La psychanalyse, dans son application clinique, cherche à explorer et résoudre les conflits inconscients du sujet. Cependant, les concepts qu’elle propose, comme
la névrose, peuvent être transposés à d’autres contextes, comme celui de l’entreprise.
Freud définit la névrose comme l’expression des conflits inconscients entre le « ça » (le réservoir des pulsions primaires, souvent inconscientes) et le surmoi (la partie morale et normative de la psyché) que le moi n’arrive pas résoudre.
Il y a conflit lorsque les désirs du ça cherchent à s'exprimer tandis que le surmoi tente de les censurer ou les réprimer, au nom de valeurs et d’interdits (notamment acquises par l’éducation, les normes sociales, …). Ce conflit peut provoquer une tension psychique importante, que le moi doit gérer. S’il n'arrive pas à résoudre ce conflit de manière satisfaisante, un mécanisme de défense s’enclenche pour éviter l’individu d’affronter ces désirs refoulés : c’est la névrose. Elle n’est pas accessible directement (mécanisme inconscient) mais marque sa présence par ces effets ou symptômes (angoisse, obsessions, phobies, …).
Dans l’entreprise, un projet de transformation du Système d’Information (SI) peut susciter des tensions similaires : les utilisateurs expriment des attentes conscientes (besoin d’un outil performant) mais aussi des craintes implicites (peur de perdre le contrôle ou de devenir obsolète).
Ces tensions se manifestent par des résistances (retard dans l’expression de besoins, critiques systématiques du projet) qui reflètent une difficulté d’adaptation.
Cet article propose une approche conceptuelle pour décoder les résistances.
Loin d’être thérapeutique, cette approche s'appuie sur les concepts psychanalytiques comme outils d’analyse pour :
- Comprendre les résistances : déceler les peurs et motivations implicites derrière des comportements parfois irrationnels
- Accompagner l’expression de besoins : favoriser un dialogue où les parties prenantes peuvent exprimer leurs craintes et attentes sans jugement
En résumé, nous allons découvrir comment la compréhension des dynamiques psychologiques peut aider la Maitrise d’Ouvrage (MOA) à naviguer en eaux troubles et à améliorer la réussite des projets
ETUDE DE CAS
L’entreprise A a choisi de déléguer à l’entreprise B la gestion opérationnelle d’un portefeuille de contrats, comprenant des tâches telles que la souscription de nouveaux contrats, la résiliation, l’encaissement des primes, le traitement des impayés, ou encore les rachats.
Chaque mois, l’entreprise B transmet à l’entreprise A des cartons remplis de feuilles papier, chacune représentant un acte de gestion réalisé durant le mois. Chaque feuille correspond à une opération spécifique : une souscription, un encaissement, ou une résiliation, par exemple.
À réception, les comptables de l’entreprise A, habitués à ce fonctionnement depuis six ans, comptabilisaient manuellement chaque opération selon une règle bien établie : une feuille équivaut à un acte de gestion, qui lui-même équivaut à une écriture comptable. Bien que maîtrisé et rodé, ce processus manuel était chronophage, générateur d’erreurs potentielles, et peu adapté aux exigences modernes de productivité et de durabilité.
Pour répondre à ces enjeux, il a été décidé d’automatiser la comptabilisation de ces actes de gestion. Les objectifs étaient multiples : accroître la fiabilité des traitements, améliorer la productivité des équipes, réduire les délais de traitement, et adopter une approche plus respectueuse de l’environnement en supprimant l’usage intensif de papier.
La MOA (Maîtrise d’Ouvrage) de l’entreprise A a joué un rôle central dans ce projet de transformation. Elle a coordonné les équipes de l’entreprise B, notamment le back-office et l’ingénierie technique, ainsi que celles de l’entreprise A, incluant les départements comptabilité et l’ingénierie technique. Son intervention a permis d’assurer une transition fluide entre les processus manuels et ceux automatisés, en prenant en compte les besoins spécifiques des métiers.
Cependant, comme dans tout projet ambitieux, cette transformation a révélé des tensions et des résistances inattendues. Ces résistances, souvent perçues comme irrationnelles et comparables à des symptômes névrotiques, méritent d’être explorées pour mieux comprendre les dynamiques sous-jacentes et les défis humains dans la gestion du changement.
RESISTANCES ET SYMPTOME NEVROTIQUES : 3 exemples concrets
1. Le retard chronique dans la validation des besoins
Le symptôme : Une équipe métier tarde à valider un cahier des charges pourtant clair. Elle repousse les réunions, demande des modifications mineures à répétition.
L’origine inconsciente : Derrière cette hésitation, un conflit se joue : le désir d’améliorer leur travail grâce au projet entre en conflit avec une peur refoulée : perte de contrôle, remise en cause de leur expertise sur l’ancien outil.
Posture de la MOA :
Face à cette situation, il est crucial de rassurer l’équipe. Clarifiez les impacts positifs pour eux, et proposez des étapes intermédiaires pour réduire l’angoisse.
2. La critique systématique des nouvelles solutions
Le symptôme : Chaque solution proposée est critiquée, souvent de manière disproportionnée : "Ce ne sera pas fiable", "Ça ne marchera pas chez nous".
L’origine inconsciente : Cette attitude peut masquer une peur inconsciente liée à l’inconnu ou à un sentiment d’insécurité ("Et si je ne suis pas capable de maîtriser ce nouvel outil ?").
Posture de la MOA :
La critique est souvent un mécanisme de protection. En tant que MOA, il s’agit de recentrer le dialogue sur les besoins réels et d’accompagner les équipes avec des formations adaptées pour renforcer leur sentiment de compétence.
3. La régression face aux nouvelles méthodes
Le symptôme : Certains collaborateurs se replient sur d’anciennes pratiques alors qu’un nouvel outil ou une nouvelle méthode est déployé.
L’origine inconsciente : Face à l’incertitude, ils retournent à un état de confort passé. C’est une forme de régression, un mécanisme typique des résistances inconscientes.
Posture de la MOA :
Acceptez ces retours en arrière comme une phase transitoire. Instaurez un accompagnement progressif et valorisez les premiers succès pour redonner confiance.
La MOA : un accompagnateur face aux résistances
Dans un projet de transformation, les résistances ne sont pas uniquement techniques ou organisationnelles. Elles touchent des dimensions humaines et psychologiques. En tant que MOA, son rôle ne se limite pas à la formalisation des besoins ou au pilotage du projet. Elle est aussi un accompagnateur du changement.
Quelques bonnes pratiques inspirées de la psychanalyse :
Identifier les résistances : Ne prenez pas les blocages pour des refus purs et simples. Cherchez à comprendre ce qu’ils cachent.
Mettre des mots sur les craintes : Le dialogue est essentiel pour apaiser les tensions et réduire les angoisses liées à l’inconnu.
Valoriser les bénéfices : Montrez que le projet répond aux besoins des équipes et qu’il est une opportunité, non une menace.
Proposer des étapes progressives : Un changement brutal provoque des réactions de défense. Une démarche par paliers réduit les résistances.
CONCLUSION : Une approche humaniste des projets
Freud, dans son concept de la névrose, formulé notamment dans "L'Interprétation des rêves" (1900), souligne les conflits inconscients sont à l’origine de comportements souvent irrationnels.
Ces dynamiques psychiques, loin de se limiter à l’individu, se manifestent également en entreprise, en particulier lors de transformations d’un SI. Dans ce contexte, des résistances peuvent apparaître sous forme de réticences au changement, d’adhésion partielle aux nouvelles pratiques ou d’angoisses liées à l’incertitude.
Les comprendre, c’est pouvoir mieux les anticiper et les accompagner.
En tant que MOA, adopter cette posture d’écoute et d’accompagnement est un facteur clé de succès. Car au-delà des outils et des processus, le véritable enjeu est humain.